Toutes sortes de fêtes sont organisées, le plus souvent en automne, temps des moissons, pour célébrer les aliments : la Fête des Vignerons, Thanksgiving, Erntedank dans les régions germaniques, Succot (fêtes des cabanes) dans le judaïsme. La Journée mondiale de l’alimentation, qui rappelle que tout le monde ne mange pas à sa faim, n’a pas été agendée par hasard en octobre. Ces manifestations, qui peuvent aujourd’hui paraître un peu déplacés dans nos sociétés postindustrielles, ont beaucoup à nous apprendre.
Traduit de l’allemand par Yvan Mudry
Qui remercie voit la face cachée des choses

Un monde entre de bonnes mains
Qui remercie se défait de l’illusion d’être maître ou maîtresse chez soi. Les choses ne nous sont pas simplement dues, elles ne sont pas à nous. La conviction qui fait dire aux rédacteurs de la Bible que la terre appartient à Dieu ne leur permet pas simplement d’affirmer que nous sommes « des étrangers et des hôtes » (Lévitique 25,23) sur la terre. Elle a une conséquence très concrète, car le droit foncier et le droit de l’endettement en tiennent compte. L’institution d’une année sabbatique – les champs doivent rester en jachère tous les sept ans –, découle de cette même approche3.
Si le sol, l’eau et l’air nous sont donnés, nous ne pouvons pas les utiliser n’importe comment. Nous restons en permanence des gardiens et gardiennes de la Création. La reconnaissance interdit d’en disposer sans ménagement. Impossible d’être à la fois reconnaissant et violent. Dire merci, c’est s’insérer dans un réseau relationnel, dans une communauté de participation et de partage. Qui ne pense qu’à soi prend ce qu’il ou elle reçoit ; qui prend ce qu’il ou elle reçoit ne pense qu’à soi. À l’origine de la reconnaissance, il n’y a ni la mentalité du « j’y ai droit » de la société de consommation et de performance, ni une obligation créant un devoir de dire merci. Gotthard Fuchs utilise une magnifique formule lorsqu’il écrit que le merci naît « d’une liberté qui s’est sentie touchée »4 parce qu’elle a perçu qu’un cadeau était offert. La fête des moissons exprime la joie procurée par la beauté de la création et la bonté de ses présents que nous pouvons savourer.

Un merci ouvert sur l’avenir
Célébrer la fête des récoltes, ce n’est pas dire naïvement merci, c’est savoir que des menaces pèsent sur la vie. C’est tenir compte des difficultés et des peines rencontrées, de l’inquiétude et de l’attente. Ayant une composante existentielle, le merci exprime alors une forme de soulagement et de confiance : que la terre fleurisse et nourrisse humains et animaux.
La fête est un signe d’espoir. Qu’allons-nous manger demain ? La récolte suffira-t-elle pour nourrir la famille ? Les réjouissances étant liées à la lutte pour la survie de la petite paysannerie, elles ne célèbrent par les surplus irresponsables, mais témoignent de la foi en la bonté de la création et de la certitude que Dieu veut notre bien. Elles ont un caractère combatif. Elles tracent le portrait d’une terre qui nous porte et peut nous nourrir, quels que soient les risques encourus.
Quelle abondance ?
Évoquons pour terminer l’abondance qui rappelle la générosité de la création et joue un rôle important dans la réflexion théologique. Dieu est débordement d’amour ou, pour reprendre la terminologie liée à la fête des récoltes, il est à l’origine de tous les biens. Mais cette question importante se pose à l’heure de la crise écologique et de l’épuisement des ressources naturelles : de quelle abondance parle-t-on ici ? Sans doute pas de celle des rayons des grandes surfaces, qui nous suggèrent d’en vouloir toujours plus parce que nous aurions toujours plus de besoins. « L’abondance dont témoigne une portion XXL de McDonald’s repose paradoxalement sur le mythe du manque. Elle suscite la peur, comme si un jour nous n’aurions peut-être plus assez à manger. »5

La fête des récoltes exprime le contraire : elle dit que nous ne sommes pas privés ! Nous ne devons pas saccager la terre, qui nous fait chaque année de nouveaux cadeaux. Il y a assez d’eau pour tous si nous ne la gaspillons pas. Et quatre multinationales ne sont pas propriétaires de toutes les semences ! Celles-ci appartiennent aux agriculteurs et agricultrices qui nourrissent le monde. La reconnaissance suit la logique du partage et pas celle de l’accumulation.




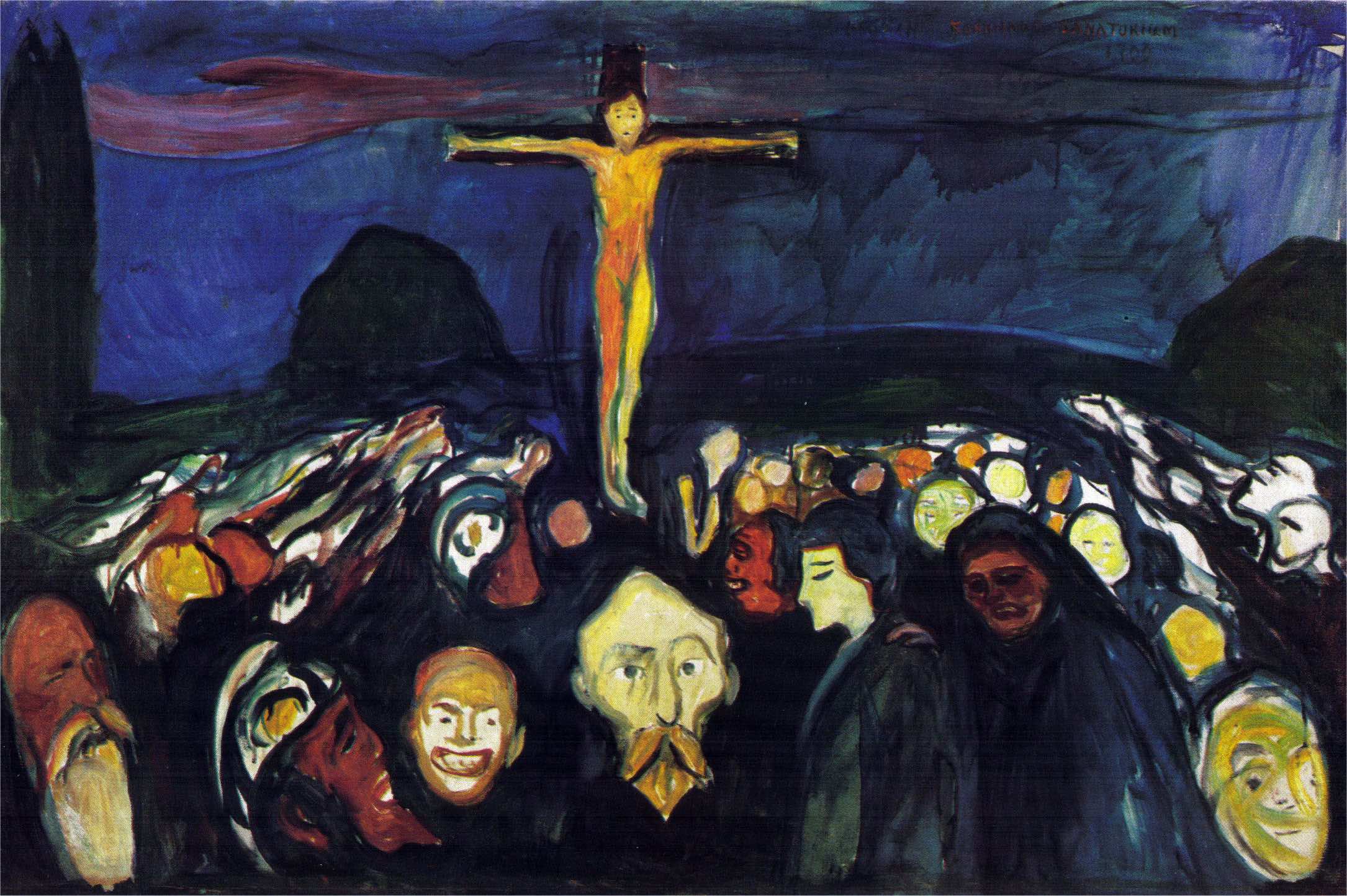
Commentaires
Pas encore de commentaire