Jour après jour, le coronavirus nous rappelle cette leçon douloureuse : nous ne pouvons pas faire de notre vie ce que nous voulons. Celle-ci tient à peu de choses ; la maladie, la souffrance sont des menaces constantes ; nous sommes vulnérables et mortels. Bien sûr, nous le savions déjà avant la pandémie. Mais depuis des mois, cette vérité apparaît encore plus crûment à nos yeux.
Traduit de l’allemand par Yvan Mudry
La Bible aussi reconnaît que l’être humain est vulnérable. Elle emploie volontiers ce mot lorsqu’elle en parle : faiblesse. Dans les Évangiles et les Actes des apôtres, ce substantif, l’adjectif « faible », ou l’expression « être faible » sont utilisés pour parler des personnes qui aspirent à être guéries de leurs maladies ou infirmités. Les récits de guérison des Évangiles le montrent clairement : des atteintes à la santé ou à l’intégrité monte un appel à un changement, car elles restreignent la liberté et rendent la vie plus difficile. Si Jésus se soucie tant des malades ou des infirmes, c’est pour une raison très simple : tout ce qui empêche de vivre pleinement doit disparaître à l’heure où s’étend le nouveau monde de Dieu, le «Royaume de Dieu » ou « Royaume des cieux ». C’est pourquoi Jésus va vers les malades et les démunis : il veut leur porter secours. Et ceux qu’il envoie pour annoncer la venue du « Royaume de Dieu » doivent faire de même – à eux de guérir les malades :
« En chemin, prêchez en disant : “ Le Royaume des cieux est proche. ” Guérissez les malades [littéralement : les faibles], ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.» (Évangile de Matthieu 10,7-8)
Là où cela se produit, là où des personnes peuvent pousser un soupir de soulagement et être guéries, là on peut « sentir » la venue du nouveau monde de Dieu annoncé par Jésus.

Toutes les maladies ne peuvent pas être guéries
Cela dit, nous le savons, toutes les maladies ne peuvent pas être guéries. Parfois il n’y a pas de retour à la santé. Bien des personnes restent malades de façon chronique ou ressentent des douleurs en permanence. Paul en a fait personnellement l’expérience dans sa chair1. C’est sans doute pourquoi il est si attentif à cette réalité : la « faiblesse » est une composante clé de la vie humaine. Quand il décrit son activité de prédicateur, il emploie l’adjectif « faible » pour dire qu’il a eu beaucoup de peine à accomplir sa tâche, qu’il a souffert. S’il utilise ce mot, c’est aussi parce qu’il ne pouvait pas être autrement que « faible », car il était dans le camp du Messie Jésus, crucifié et ressuscité des morts par Dieu. Car qui reconnaît un pan fondamental du mystère de Dieu jusque dans un Messie crucifié ne peut pas l’annoncer avec brio et sans hésitation. Il n’en parlera qu’en tâtonnant et en prenant au sérieux les problèmes de la vie. C’est pourquoi, dans sa prédication, Paul ne correspond pas à l’image qu’on se fait habituellement d’un orateur – celui-ci doit être un maître de l’art oratoire. Il s’est montré « faible, craintif et tout tremblant » (1 Lettre aux Corinthiens 2,1-5). Cette fragilité lui permet de faire l’expérience de la puissance de Dieu, qui agit dans la faiblesse. C’est ainsi qu’il peut dire : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2 Lettre aux Corinthiens 12,10). Il peut donc accepter sa vulnérabilité personnelle et vivre en faisant confiance à Dieu.
Ce qui est blessé sera transformé
Paul porte un regard très réaliste sur la vie humaine lorsque, dans le grand chapitre sur la résurrection de la Première Lettre aux Corinthiens, il qualifie cette vie de corruptible, d’éphémère et de « faible ». Il reconnaît ainsi que les êtres humains sont vulnérables, qu’ils tombent malades, qu’ils vieillissent et qu’ils meurent, mais aussi qu’ils sont victimes d’injustices et d’actes de violence, et exposés à la destruction. Mais Paul en est aussi convaincu : ce sont précisément ces êtres fragiles, blessés et démunis que la force créatrice de Dieu ressuscitera pour leur offrir une nouvelle vie en pleine santé. Ainsi connaîtront-ils l’immortalité, la gloire et la force :
« Les semailles se font dans l’impermanence, la résurrection dans la permanence ; les semailles se font dans la médiocrité, la résurrection dans la gloire ; les semailles se font dans la faiblesse, la résurrection dans la force […]. » (1 Lettre aux Corinthiens 15,42-43)2
Si Paul utilise ici l’image des semailles, c’est sans doute pour dire qu’il y a une différence radicale entre la réalité issue de la résurrection et l’existence physique terrestre. Nous savons tous en effet que la plante née d’une graine est très différente de celle-ci. Mais Paul utilise peut-être aussi cette image pour montrer qu’il y a un lien de continuité entre la réalité issue de la résurrection et l’existence physique sur terre. Car la plante qui naît d’une graine a un lien avec celle-ci – elle n’existerait pas sans elle. Ce qui est semé, la graine, est « transformé », et quelque chose de nouveau en sort. Qu’est-ce que cela dit de la résurrection ? La réalité issue de la résurrection porte en elle la personne tout entière, son histoire, ses blessures, ses souffrances, mais aussi les expériences de bonheur et d’espoir qui ont été les siennes. Toutes les composantes de la vie humaine ne sont pas effacées. Elles sont reprises sous une autre forme, elles sont transformées, guéries. Paul replace ainsi la faiblesse et la vulnérabilité humaine dans le grand courant de la puissance créatrice de Dieu et de cette espérance : nous aurons part, grâce à Dieu, à la vie en plénitude.

Une image positive de l’être humain
Ces versets sur la faiblesse humaine peuvent véhiculer une idée très négative de l’être humain. Ils peuvent faire croire que la condition humaine n’est faite que d’imperfections, et que l’existence incarnée et la finitude, constitutives de notre humanité, sont dépourvues de valeur. C’est précisément ce qui a été fait à de nombreuses époques de l’histoire de la théologie chrétienne. Ce n’est pourtant pas là le message véhiculé par les textes bibliques. Ceux-ci nous apprennent au contraire à accepter notre condition de créature, ainsi que notre corps. C’est pourquoi nous ne devons pas nous rebeller contre cette donnée de base de notre humanité : nous sommes faibles et vulnérables. Cela signifie d’abord que nous sommes limités, que nous n’avons pas la haute main sur tout, que nous ne sommes pas tout-puissants. Mais cela signifie aussi que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, que nous ne sommes pas à l’origine de notre existence – nous en sommes au contraire redevables à d’autres : à nos parents et, en fin de compte, à Dieu. Nous ne sommes pas indépendants, détachés de tout, nous ne sommes pas dépourvus de tout lien avec quoi que ce soit d’autre que nous. Au contraire, nous avons besoin des autres et nous sommes liés à eux. Nous nous inscrivons au sein de la création et nous sommes face à Dieu.
Qui s’observe lui-même à cette lumière jette un autre regard sur soi et sur le monde qui l’entoure. Certes, l’être vulnérable peut être blessé, mais il peut aussi être touché. C’est ainsi que la vulnérabilité ouvre de nouveaux chemins :
« Sans elle [= la vulnérabilité], pas d’empathie ni de solidarité, pas d’amitié, d’amour ni de cohésion sociale. C’est uniquement parce que nous sommes ouverts, vulnérables, que la paix peut être établie, ce qui constitue l’une des plus hautes réalisations de l’être humain, sans laquelle l’humanité n’aurait aucune chance de survivre. »3

Voilà sans doute l’une des plus belles choses que la vie puisse nous réapprendre en temps de pandémie. Oui, nous nous heurtons à des limites, oui, nous devons tout faire pour maîtriser le virus et lutter contre lui. Mais en même temps, en étant confrontés à nos limites et en apprenant que nous ne sommes pas tout-puissants, nous pouvons mieux nous connaître, être plus attentifs aux autres et plus conscients des failles de l’existence. N’hésitons pas à tâtonner et, en même temps, restons prudents. Soyons ouverts à l’amour et au bonheur, à la joie et à ce qui a du sens ; soyons attentifs à nous-mêmes et aux autres, responsables les uns des autres, solidaires. Que cette espérance nous anime : Dieu est présent et agissant tout particulièrement lorsqu’une pandémie provoque quantité de bouleversements et de remises en cause.
- Cf. Sabine Bieberstein: Quand la vie est marquée par la maladie, su: question-de-foi.ch
- Traduction du texte grec de Sabine Bieberstein: Der Erste Korintherbrief. Der Erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth aus dem Urtext übersetzt und kommentiert, dans: Paulus schreibt den Gemeinden. Die sieben Briefe des Apostels aus dem Urtext übersetzt von Sabine Bieberstein, Martin Ebner, Hildegard Scherer et Stefan Schreiber, éd. Anneliese Hecht, vol. 1, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2020, p. 342.
- Hildegund Keul / Thomas Müller (éd.): Verwundbar. Theologische und humanwissenschaftliche Perspektiven zur menschlichen Vulnerabilität, Würzburg 2020, p. 9.
Crédits photos: Photo de couverture: iStock/Nes; Photo 2 et 3: Lou, Olivia, Duna, Sanna II, Laura III: Sculptures en albâtre de l’artiste Jaume Plensa. Albâtre. Événement parallèle à la Biennale d’art de Venise 2015. Abbaye bénédictine de San Giorgio Maggiore, Officina dell’Arte Spirituale; Photo 4: iStock/Daisy-Daisy




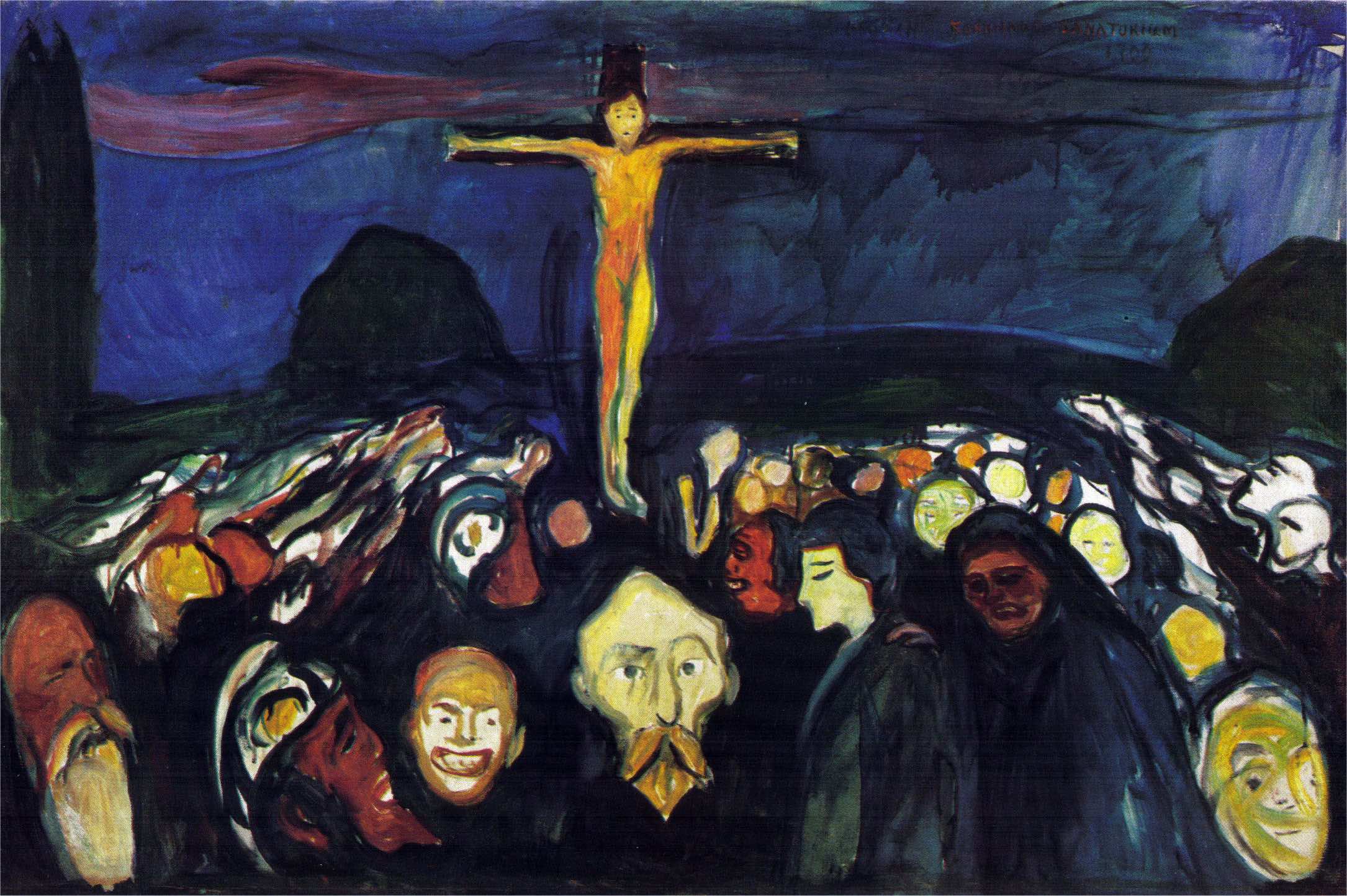
Commentaires
Pas encore de commentaire