L’être humain est capable du meilleur et du pire. Nous ne devons jamais cesser de croire qu’il peut être bon, nous montre la Bible.
Traduit de l’allemand par Yvan Mudry
« Homo homini lupus est », « L’homme est un loup pour l’homme ». Voilà comment Thomas Hobbes (1588-1679) décrit l’être humain. La formule choc, restée dans les mémoires, permet au philosophe anglais de faire état, froidement, de ce qu’il croit voir autour de lui. À son époque, comme dans les contes des frères Grimm, le loup était l’incarnation des dangers et de l’imprévisibilité de la nature. On ignorait encore tout de son comportement social avec ses congénères. Pour Hobbes, l’homme se comporte comme un loup non seulement lorsqu’il recourt à la force brute, mais surtout lorsqu’il trouve des astuces pour agir en prédateur. C’est ainsi que même les petits et les faibles peuvent vaincre les forts en utilisant du poison ou en recourant à d’autres stratagèmes. Voici donc le cœur de la vision du philosophe : personne n’est à l’abri de personne. La formule latine est ainsi au fondement de sa grande œuvre, « Léviathan », qui répond à la question suivante : comment faire barrage à l’agressivité de loup et à la soif de destruction de l’être humain ?

Tout semble montrer que l’être humain se comporte aujourd’hui encore comme Thomas Hobbes le disait. On peut faire de nombreux parallèles entre certains événements actuels et ce qui se passait dans les années 1640. Il y avait alors une guerre civile en Angleterre, elle faisait de nombreuses victimes dans les deux camps et provoquait un immense chaos – la vision de l’être humain de Hobbes a été profondément influencée par ce conflit. Aujourd’hui, pour ne prendre qu’un seul exemple, des populations entières sont obligées de fuir leurs foyers dans différentes régions du monde. Selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 82 millions de personnes vivaient en exil à la fin de l’année 2020, soit avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Impossible de se représenter les foules ainsi déplacées. Certaines personnes prennent sans doute la fuite pour d’autres raisons que la guerre, l’expulsion de chez soi ou l’imminence d’un danger mortel. Toujours est-il qu’on ne fuit pas les autres humains sans courir de risques et subir des traumatismes. Et si on le fait, c’est presque toujours parce qu’on n’a aucun autre moyen d’échapper au malheur.
L’homme est un loup pour l’homme. L’être humain ne prend pas seulement la fuite lorsque sa vie est en danger. Il le fait aussi dans toutes sortes d’autres circonstances, moins dramatiques, que nous connaissons bien, nous qui vivons dans des États d’Europe où la sécurité règne. « Ici, je suis un être humain, ici je peux l’être », écrit le grand Goethe dans « Faust », l’une des œuvres les plus importantes de la littérature allemande. Cette phrase célèbre, combien de personnes ne pourraient la prononcer que dans de courts moments de « bonheur », en vacances, lors d’une pause bien-être, quand elles font des achats ou assistent à des manifestations culturelles ! C’est là de l’« escapisme », pour reprendre un nouveau mot, de l’évasion à l’état pur, en réaction à un quotidien qui en demande trop, est sans cœur et ne pardonne pas. Que ce soit au travail, en famille ou même entre amis, partout la nature carnassière de l’être humain peut ressortir d’une manière ou d’une autre. Elle pousse par exemple à dire du mal, à éprouver de la jalousie ou à harceler moralement. Rien d’étonnant si les médias sociaux sont aujourd’hui le repaire de meutes de loups, qui n’hésitent pas à s’en prendre aux plus faibles.

D’une manière ou d’une autre, nous devons souvent prendre la fuite pour échapper aux loups. Plus encore, et c’est honteux, nous ne pouvons pas, nous-mêmes, nous défaire de nos peaux de loups. Car, reconnaissons-le, combien de fois nous sommes du côté des brutes – du moins selon les autres !
En traçant son sinistre portrait de l’homme, Hobbes ne met toutefois en avant qu’une seule face de la médaille. Sur l’autre apparaît une figure très différente : celle d’un être capable d’apprendre, soucieux du bien commun, assoiffé de bonheur et de solidarité. Ce profil a été décrit notamment par le Genevois Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), mais on peut ajouter à son nom ceux des humanistes et de presque tous les philosophes de l’époque des Lumières. Ces penseurs et penseuses affirment que l’être humain peut devenir meilleur, qu’il peut rechercher ce qu’il y a de plus élevé, le bien. Quel soulagement de voir aussi à l’œuvre ce bon côté de l’humain dans la vie de tous les jours ! C’est ainsi que de nombreuses personnes viennent en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou aux réfugiées et réfugiés sans rien attendre en retour. Beaucoup d’autres exemples vous viennent sans doute immédiatement à l’esprit.

Cette particularité de l’être humain, capable à la fois du meilleur et du pire, a fasciné et, en même temps, irrité les philosophes et les théologiens à toutes les époques. Comment se fait-il qu’une créature puisse, d’un côté, se battre et assassiner et, de l’autre, aider jusqu’à se sacrifier soi-même ? Personne n’a mieux décrit ce phénomène que le philosophe italien de la Renaissance Pic de la Mirandole (1463-1494), dans un texte intitulé « De la dignité de l’homme » :
« L’être humain en revanche est libre et placé au centre du monde, afin qu’il puisse regarder autour de soi, examiner ce qu’il voit et faire ses choix. C’est ainsi qu’il se façonne lui-même, en décidant librement d’être ceci ou cela, et de vivre ici ou là. C’est là ce qu’il y a de merveilleux dans sa nature et là que réside sa dignité particulière. C’est aussi en cela qu’il est à l’image de Dieu. Il n’est ni céleste ni terrestre. C’est pourquoi il peut décider de devenir un animal et même une plante qui végète ou, au contraire, développer sa pensée pour être semblable à un ange. »
Pic de la Mirandole reprend manifestement des éléments des récits de la création : l’homme est à l’image de Dieu, parce qu’il participe à son activité créatrice. Ce qui est presque plus important encore, étant libre, il est invité, voire contraint à réfléchir continuellement à ses actes et à les justifier devant son tribunal intérieur, sa conscience. L’homme doit ainsi relever un défi, il ne peut pas renoncer à faire usage de sa liberté. Incapable de se transformer en automate à volonté, il est obligé de se modeler lui-même ainsi que son environnement, quitte à devenir un animal, comme le dit l’humaniste italien. Le livre de la Genèse et même la Bible tout entière montrent à quoi cela peut conduire. Ayant à choisir entre les pôles « céleste » et « terrestre », pour reprendre le vocabulaire de Pic, l’homme peut emprunter des chemins tortueux dans ses relations avec les autres – inutile d’en dire plus, il suffit de mentionner ici les noms de Caïn et Abel, Saül et David, Jésus et Judas…

La Bible n’est ni un manuel scolaire ni un livre de morale qui décrirait la nature de l’être humain. Elle dit de différentes manières de quoi celui-ci est capable dans les domaines du bien comme du mal – elle montre aussi qu’il est toujours « rattrapé » par son Dieu, même lorsqu’il a commis la faute la plus grave ou a perdu ses repères intérieurs. En mettant en lumière les problèmes de la vie et les enjeux de nos décisions, elle transmet ainsi un message capital, qui tranche sur celui des philosophes, parce qu’il témoigne d’une espérance : « Faites confiance à Dieu, miséricordieux et plein d’amour, reconnaissez vos faiblesses si humaines, essayez malgré tout de vous soucier des autres ! » Pour le dire avec Jésus : « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Évangile de Jean 13,34)
Ce commandement dévoile le fond de l’approche chrétienne : ne pas désespérer de l’être humain, continuer à croire que, malgré tout, il peut être à l’image de Dieu et non pas du loup. Ça n’est jamais facile, mais quel autre chemin emprunter pour vivre en harmonie les uns avec les autres sur notre petite planète ?1
- Crédits photographiques: Couverture: iStock / Image 1: La “Loupe du Capitole” avec les fondateurs de Rome, Romulus et Remus, les Muses du Capitole, Rome. Unsplash@dabliu_andrea / Image 2: Massage à l’huile d’armoa. Unsplash@caishan119 / Image 3: Manifestation NoFrontex 23 avril 2022 Berne, Suisse. Unsplash@mortaza_shahed / Image 4: Le plafond de la chapelle Sixtine, Vatican. Unsplash@_calvincraig




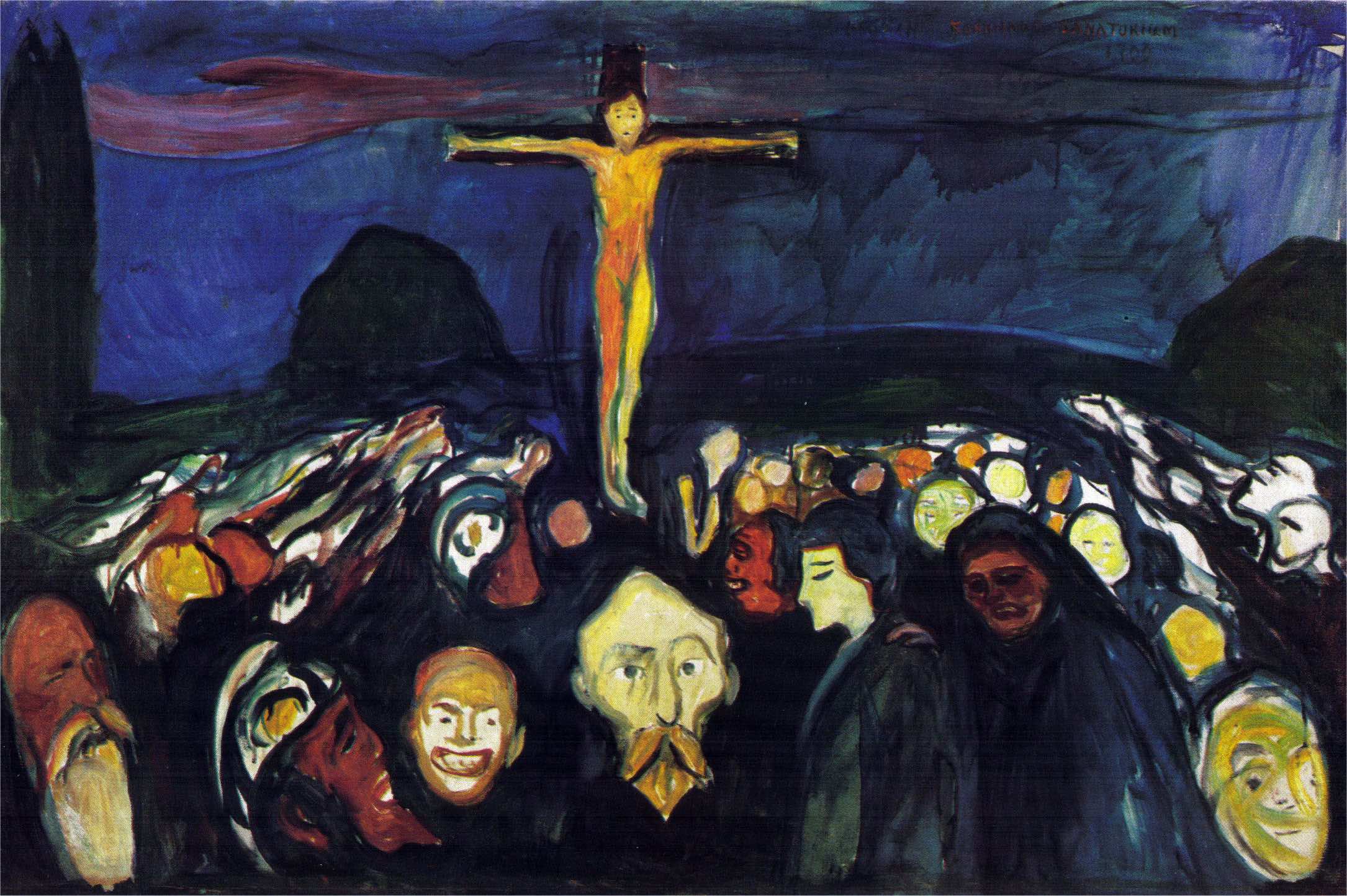
Commentaires
Pas encore de commentaire